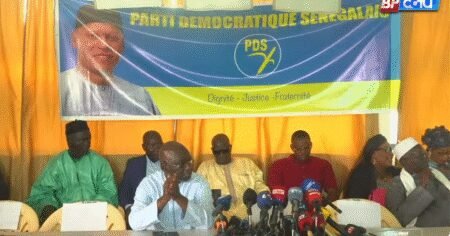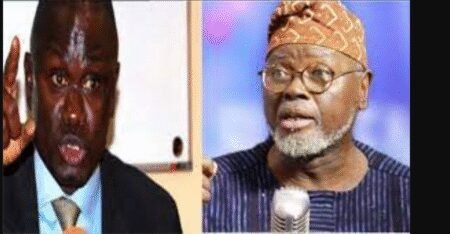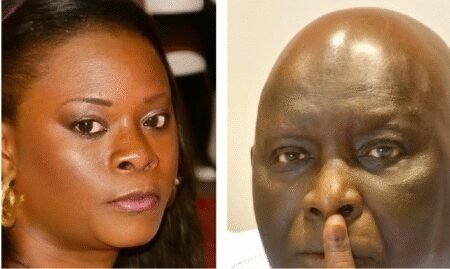Il y a des maladies dont on parle trop tard, trop peu, trop mal, ou pas du tout même.
Le Papillomavirus humain (HPV) en fait partie. Ce virus, sournois, banal, presque invisible dans le brouhaha de nos urgences sanitaires, ronge des vies silencieusement. Il ne fait pas de bruit, il nŌĆÖ├®clate pas les ├®crans comme le fit le Covid, il nŌĆÖenflamme pas les plateaux t├®l├®, il ne mobilise ni campagnes massives ni budgets vertigineux. Et pourtant, il tue, il d├®sarme, il d├®sesp├©re.
Chaque ann├®e, des milliers de jeunes gens en Afrique comme en Europe sont frapp├®s par les cons├®quences du HPV : l├®sions, st├®rilit├®, cancer du col de lŌĆÖut├®rus, douleurs, honte, peur. Et souvent, tout commence dans le silence ŌĆö celui du manque dŌĆÖinformation, de pr├®vention, de d├®pistage.
Octobre rose… mais apr├©s ?
Oui, Octobre Rose existe.
Ce mois o├╣ lŌĆÖon voit des rubans roses fleurir sur les v├¬tements, sur les affiches, sur les visages. Ce mois o├╣ lŌĆÖon parle ŌĆö enfin ŌĆö du cancer du sein, de la pr├®vention, de la dignit├® des malades. CŌĆÖest beau. CŌĆÖest n├®cessaire.
Mais le reste de lŌĆÖann├®e ?
O├╣ sont les campagnes pour le papillomavirus ? O├╣ sont les d├®bats sur la vaccination pr├®ventive ? O├╣ sont les ├®missions qui expliquent, les m├®decins qui rassurent, les pouvoirs publics qui sŌĆÖengagent ?
Parce que le HPV ne dort pas en novembre. Il ne prend pas de vacances en janvier.
Il continue de d├®truire des vies, de sŌĆÖinstaller dans des corps ignorants, souvent pauvres, souvent jeunes.
Regards crois├®s : entre la France et le S├®n├®gal
Entre mes deux rives, je mesure les in├®galit├®s criantes.
En France, on vaccine d├©s 11 ans, on d├®piste, on informe. Les adolescentes re├¦oivent des brochures, les familles sont alert├®es, la pr├®vention devient r├®flexe.
En Afrique, dans nos pays, dans nos villages, dans nos quartiers m├¬me, la r├®alit├® est toute autre : le tabou, la pudeur, la peur du ŌĆ£mal f├®mininŌĆØ.
On tait ce quŌĆÖon ne comprend pas. On cache ce quŌĆÖon croit honteux.
Et pendant ce temps, des jeunes meurent dŌĆÖune maladie pr├®visible et ├®vitable.
Le papillomavirus est un tueur silencieux, mais aussi un r├®v├®lateur social. Il expose les failles de nos syst├©mes de sant├®, le d├®sint├®r├¬t de nos politiques pour la sant├® f├®minine, la frilosit├® de nos m├®dias ├Ā parler du corps des femmes autrement que sous lŌĆÖangle du glamour ou du scandale.
Un plaidoyer pour les corps, les voix, et la dignit├®
Il faut dire les choses.┬Ā┬Ā
Le corps f├®minin nŌĆÖest pas quŌĆÖun symbole. CŌĆÖest un territoire de sant├® publique.
Et ce territoire m├®rite protection, ├®ducation, pr├®vention.
Les jeunes filles doivent savoir quŌĆÖun simple vaccin peut sauver leur avenir.
Les m├©res doivent ├¬tre accompagn├®es pour comprendre, pr├®venir, d├®pister.
Les m├®dias doivent assumer leur r├┤le dŌĆÖ├®ducation populaire.
Et les pouvoirs publics doivent agir ŌĆö non pas une fois par an, mais chaque jour, dans chaque dispensaire, chaque ├®cole, chaque quartier.
┬Ā
LŌĆÖespoir et la responsabilit├®
Ce que je retiens de mes ŌĆ£regards crois├®sŌĆØ, cŌĆÖest quŌĆÖentre le Nord et le Sud, lŌĆÖespoir existe.┬Ā Des associations locales sŌĆÖengagent. Des femmes se l├©vent. Des m├®decins militent. Mais il faut plus quŌĆÖun mois rose
Il faut une ann├®e multicolore, d├®di├®e ├Ā toutes les luttes f├®minines.
Une ann├®e o├╣ la sant├® des femmes devient cause nationale et universelle.
Parce quŌĆÖune soci├®t├® qui laisse ses femmes tomber malades en silence est une soci├®t├® malade dŌĆÖindiff├®rence.
Alors, en ce mois dŌĆÖoctobre, je ne veux pas seulement voir du rose.
Je veux voir du rouge de courage, du blanc de dignit├®, du bleu dŌĆÖesp├®rance.
Je veux entendre les voix des femmes dire : ŌĆ£Mon corps m├®rite quŌĆÖon sŌĆÖen occupe, quŌĆÖon le soigne, quŌĆÖon le respecte.ŌĆØ
Et je veux que chaque fille, chaque m├©re, chaque s┼ōur, chaque compagne, sache que le papillomavirus nŌĆÖest pas une fatalit├®, mais un combat que nous pouvons gagner ŌĆö si nous le menons ensemble, sans honte, sans tabou, et sans rel├óche.
Marie┬Ā Barboza MENDYŌĆō Regards crois├®s dŌĆÖune Franco-S├®n├®galaise
mendymarie.b@gmail.com
TEL. 78 291 83 25
┬Ā
Lire l’article original ici.